Culture
23/06/2022
Guillaume Le Goff
Le point commun entre un artiste graffiti français maître en flops et tags hautement stylés, ayant collaboré avec Virgil Abloh et Off-White en 2021, un peintre, sculpteur, éditeur de publications DIY, et un street skateur qui a connu le ‘golden age’ des années 90 ? C’est un nom : GUES
Une personnalité à la créativité et à la réflexion fascinantes, connue des néophytes, mais pas vraiment du grand public – il gagnerait à l’être – et dont nous sommes heureux de vous présenter le parcours, les idées et le travail.
 @littledeadbodies
@littledeadbodies
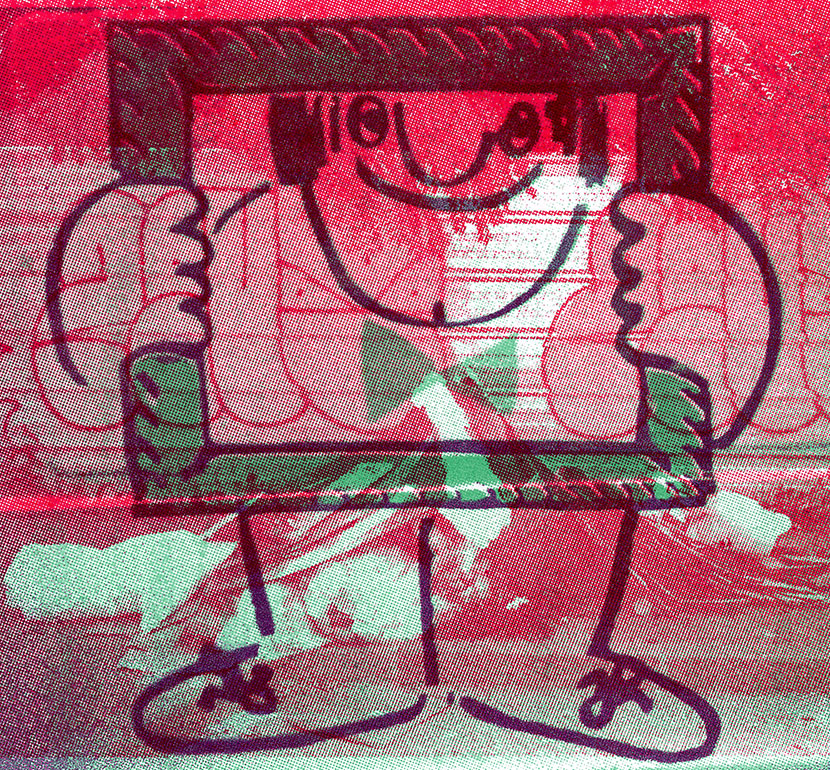 @littledeadbodies
@littledeadbodies
Quel regard portes-tu sur le mouvement graffiti actuel ?
Si on part du principe que le graffiti est un mouvement, on peut dire qu’il évolue en permanence, se transforme et s’adapte en fonction des avancées technologiques et des moyens de diffusion. Depuis une trentaine d’années, les outils disponibles sont devenus performants et accessibles. Un business florissant a vu le jour avec de nombreuses marques de bombes de peinture, de marqueurs, et d’encres dédiés spécifiquement à la pratique du graffiti. L’avènement d’internet, des sites et des forums, puis des réseaux sociaux a contribué à son expansion. Il y a donc logiquement de plus en plus de gens qui peignent et qui ont la possibilité d’être autonome pour diffuser leurs œuvres, quelles qu’elles soient. Cette contre-culture, comme mode de résistance, a été absorbée, digérée et transformée par la culture dominante. C’est le principe de l’évolution de toutes les contre-cultures dans une société dominée par le capitalisme et le néo-libéralisme. Je précise que c’est un constat de ma part, on ne peut pas lutter contre cette évolution, ou la refuser à moins de vivre complètement en marge de la société. Il ne s’agit pas de dire que c’était mieux avant et de fantasmer une origine supposée du graffiti, c’était juste différent. On peut désormais être totalement autonome : se faire livrer son matériel, peindre dans des spots repérés sur Google Maps, prendre des photos en numérique et diffuser ses œuvres sur les réseaux (bientôt dans le metaverse ?). À mon sens, un des problèmes auxquels se confronte la nouvelle génération réside dans le choix de la documentation à disposition. Comment faire le tri dans cette infinité d’informations et interroger les sources non hiérarchisées qui circulent librement ? Subsiste heureusement l’esprit communautaire : rencontrer d’autres personnes IRL, créer du lien, échanger… Pour faire en sorte que cette pratique reste vivante.
Pour les puristes, je n’ai aucune inquiétude. Les trains et métros sont toujours à peindre et la sécurité à défier. Le jeu du chat et de la souris et l’aventure sont toujours possibles. Les billets low-cost ont, depuis longtemps, remplacé les billets Interrail, ce qui permet une exploration encore plus vaste des différents réseaux ferroviaires.
Et sur la fameuse transition entre rue et galerie (voir univers du luxe), qui s’est opérée depuis quelques années ?
Pour répondre à cette question, il faudrait distinguer les différents types de galeries : parle-t-on d’art contemporain, d’art brut, de street-art ou d’autre chose à définir (sans jugement de valeur de ma part) ? En France, la transition vers l’art contemporain reste difficile, même si le graffiti est une pratique picturale contemporaine. Il faut maîtriser un certain nombre de codes artistiques et sociaux, parfois les briser pour susciter de l’intérêt. On n’a aucune garantie d’avoir une carrière artistique en tant que graffeur reconnu. Ces deux univers se frottent et se toisent parfois, quand ils ne s’ignorent pas tout simplement. On assiste à une sorte de porosité ponctuelle. Barry Mc Gee, Todd James et Dash Snow, pour citer des noms connus, en sont des exemples. Je crois que la différence opère en raison de l’origine géographique de leur succès. Aux États-Unis, le concept de Folk art dans lequel peut s’inscrire une certaine forme de graffiti est bien plus développé qu’en Europe.
En France, on lui préfère le terme d’art brut défini par Jean Dubuffet. La porosité vers l’art contemporain peut s’opérer par transformation, par mutation. On parle alors d’artistes issus du graffiti qui ont su conserver leur énergie créatrice en opérant un twist conceptuel. Je pense à Antwan Horfée par exemple. On ne peut pas trop compter sur l’institution pour faire bouger les lignes, même si cela est ponctuellement rendu possible avec des initiatives de piraterie/hacking orchestrées par Hugo Vitrani au Palais de Tokyo : un sacré défi !
J’ai du mal à comprendre l’expression « issu du graffiti » qui sous-entend qu’on en a fini avec le graffiti et qu’on est passé à autre chose. Je ne considère pas le graffiti comme un boulet, ou une chose encombrante qu’on doit laisser derrière soi pour entamer une carrière artistique noble. L’aboutissement ne réside pas forcément dans la monstration de son travail dans le white cube.
On peut heureusement imaginer d’autres manières de procéder, d’inventer, il ne s’agit pas de présenter par glissement ce qu’on fait dans la rue, à l’extérieur, sur une toile stricto sensu. En-dehors de l’univers feutré et codifié de l’art contemporain existent d’autres territoires d’expression, d’autres lieux qui laissent leur chance aux graffeurs. De plus en plus de galeries voient aussi l’opportunité de présenter une vision contemporaine du monde par des artistes engagés et questionnant leur pratique. Comment concilier le geste, gratuit par essence, du graffiti et une rémunération assumée pour la vente de ses œuvres ? Je n’ai pas la réponse, c’est une gymnastique intellectuelle constante. L’univers du luxe, différent de celui des galeries, permet un autre angle d’attaque pour présenter son travail. Ce n’est pas la même finalité, ni les mêmes moyens… Mais on va y revenir.

Tu as également beaucoup pratiqué le skateboard à Paris à une époque un peu bénie, le « golden age » des années 90’/00’… En quoi le skate a-t-il influencé dans ta pratique du graffiti art, puis de ton œuvre artistique globale, et vice versa ?
Je suis arrivé au graffiti par le skate au début des années 90’. Avec mon frère cadet, nous avons tout de suite adhéré à cette pratique urbaine, fascinés par cette contre-culture américaine, au-delà d’un simple sport, alliant style vestimentaire, marques à l’identité graphique très forte et culture musicale. En plus, on bénéficiait d’une totale liberté, sans hiérarchie. Pour progresser, on n’avait pas besoin d’aller à des entraînements ou de participer à des compétitions. L’apprentissage et l’émulation se faisaient dans la rue, entre potes sur des spots qu’on découvrait à l’occasion de grands rides à la Défense. On trouvait nos références dans les vidéos VHS et quelques magazines dont Noway (l’unique magazine français de skate disponible en kiosque) et d’autres, importés des États-Unis : Thrasher, Transworld, Slap. Les skateshops à Paris se comptaient alors sur les doigts d’une main. L’impact visuel très fort a tout de suite imprégné ma rétine de jeune ado. Au début des années 90, c’est un peu le creux de la vague, Powell Peralta et Santa Cruz cèdent progressivement la place à l’univers de Rocco. Les boards et le style évoluent, se transforment en direction d’une pratique orientée plus “street”. Les graphiques et les formes des boards me faisaient rêver, c’est toujours le cas, de Marc McKee à Mark Gonzales en passant par Neil Blender, Natas Kaupas ou Ed Templeton, la liste est longue. Je commençais à saisir que les skateurs étaient aussi peintres, dessinateurs, vidéastes… Bref des artistes qui ne se fixaient aucune limite concernant leur moyen d’expression dans un esprit DIY. Autonomes, ils créaient leur identité qu’on retrouvait en vidéo ou dans les publicités parfois délirantes, publiées dans les premiers numéros de Big Brother, que je conserve précieusement. J’y découvre le graffiti qui fait partie intégrante du décor en analysant scrupuleusement photos et vidéos. La documentation étant assez rare et précieuse à l’époque, on décortiquait souvent les vidéos, image par image, en bousillant nos magnétoscopes pour comprendre les tricks.
Skate et graffiti sont intimement liés pour moi. Je ne l’ai compris que tardivement en prenant le recul nécessaire pour saisir les raisons de ma passion pour les deux. Pourquoi ne pas avoir choisi l’un au détriment de l’autre ? Il s’agit dans les deux cas de réappropriation de l’espace urbain en fonction d’un certain nombre de codes, d’un goût pour l’exploration, et de pratiques hors structure, sans aucune hiérarchie à respecter. Tout s’apprend sur le tas. On exploite les failles et les non-lieux de l’espace urbain. Dans le skate, on détourne la fonction de base du mobilier urbain par exemple. Avec cette lecture particulière de l’environnement, on a l’impression d’habiter réellement la ville. On établit une cartographie personnelle des lieux de regroupement et de rencontres avec un intérêt commun pour un spot. Ceci dit, avec le recul, je constate que cette liberté est toute relative. Dans la construction de l’adolescence, on a souvent besoin d’appartenir à une tribu, ou à un crew, en rupture avec le monde des adultes. On reproduit des comportements et des attitudes issus d’un modèle qu’on adapte, tout en ayant l’impression de n’avoir aucune contrainte. En vieillissant, j’ai conservé le goût pour un risque mesuré, pour l’improvisation et la fugacité du geste. J’espère toujours avoir une lecture différente et personnelle du milieu dans lequel j’évolue. En jouant avec les contraintes, le skate nourrit toujours ma pratique du graffiti et ma pratique artistique, et inversement. Même si mon corps le permet moins à mon âge, je skate encore. Je n’ai toujours pas trouvé d’équivalent à la sensation inégalée de liberté que je ressens sur ma board. D’un côté, je regarde toujours beaucoup de vidéos que je trouve bien plus inspirantes que celles de graffiti. J’y puise entre autres de nombreuses références musicales. De l’autre, je me nourris du graffiti par les livres et publications que je collectionne, c’est un rapport différent à l’image qui m’a amené à m’intéresser à la peinture et à la photographie entre autres. Dans les deux cas, ce n’est pas la performance ou la technique qui m’intéresse, mais le style, une chose assez insaisissable pour le profane.
Il n’est pas aisé d’associer un style en particulier à ton travail… Un élément qui revient régulièrement est le fameux flop GUES avec ces différentes variations qui est devenu comme une sorte de logo. Peux-tu nous en parler, et lorsque tu peins, opères-tu avec une certaine « stratégie » ?
Ce throw-up est largement inspiré par la tradition américaine passée et actuelle. Il s’agit de la maîtrise d’un ensemble de gestes, simples d’aspect, mais qui demande beaucoup d’entraînement avec un minimum de moyens : une couleur de remplissage et un contour sans retouche, en un minimum de temps. C’est une recherche d’efficacité visuelle qui requiert une dextérité que je n’ai pas toujours. Comme pour un trick de skate basique, quand on parle de style, on juge la “beauté” d’un throw-up par l’aisance et l’élégance de son auteur. La réussite est difficilement quantifiable. Il s’agit de revenir à la base, à l’essence d’un graffiti que je considère comme essentiel, un truc de puriste finalement. Pas de chichis stylistiques élaborés pour camoufler une maladresse, tout réside dans l’équilibre ou le déséquilibre. Si mon throw-up devient une sorte de logo identifiable par tout le monde, l’objectif est atteint. J’en fais varier sa taille, mais aussi son sens de lecture. Sachant que je suis gaucher, j’ai toujours eu beaucoup de difficulté à écrire ou à dessiner de la gauche vers la droite, ma main masquant mon tracé. Je me suis donc mis à tracer mon throw-up en miroir, de la droite vers la gauche ce qui renforce un peu plus son étrangeté et l’impact du G qui est devenu à force de tentatives, et malgré moi, une sorte de tête grincheuse, grimaçante. Ma stratégie, s’il y en a une, ne diffère pas de celle des autres : en faire beaucoup, jusqu’à écœurement, saturer l’espace et changer le plus possible de support. En option, trouver d’autres alias pour ne pas se lasser et brouiller un peu les pistes.
Tu montres également un vif intérêt pour les livres, les fanzines et les publications DIY, avec de multiples projets et collaborations, quel est ton rapport avec ce médium ?
Je suis attaché à l’objet papier, toute ma documentation, quel que soit le sujet, se trouve dans des livres qui débordent de ma bibliothèque pour envahir mon appartement. J’aime feuilleter les pages d’un ouvrage, le soupeser, avoir un contact direct avec l’objet, ce qui ne sera jamais possible avec un écran d’ordinateur ou celui d’un smartphone. Le livre magnifie le sujet qu’il traite, que ce soit du texte, de la photo ou du dessin. De plus, je lis quantité de romans, j’ai un appétit insatiable pour la lecture. Cet intérêt est aussi lié à mon histoire personnelle, j’ai eu l’habitude de me documenter dans des fanzines, des magazines et des livres. Dans les années 90, l’information ne circulait pas sur les réseaux, la temporalité n’était pas la même, on pouvait trouver dans certaines boutiques des fanzines de graffiti ou des magazines de skate qui sortaient plusieurs fois par an, parfois de manière erratique, ce qui participait à la préciosité de l’objet.
Je me suis rendu compte que, passé le plaisir d’être publié et diffusé dans des fanzines spécialisés de graffiti, il ne restait pas grand-chose de tout ce que j’avais envie de montrer. Finalement, c’était une photo de graffiti parmi d’autres, noyée dans la masse. Pourquoi ne pas le faire soi-même ? La publication DIY me permet de diffuser mon travail, d’en montrer des bribes sélectionnées, du dessin à la photographie argentique en passant par le texte de fiction. Je peux articuler le graffiti avec ce qui me préoccupe et ce qui m’agite en façonnant à la main des objets à la photocopieuse ou en risographie par exemple. Il n’y aucune limite, à part celles que je me fixe. De cette manière, je peux aussi choisir avec qui je travaille, j’apprécie l’idée de confier un corpus d’images et un texte à un ami graphiste/maquettiste, je lui fais confiance. En lui fournissant de la matière qu’il façonne à sa manière, un dialogue s’opère alors. Je travaille aussi sur des projets à plusieurs mains avec d’autres artistes pour réaliser des publications. Des maisons d’édition indépendantes comme Les Éditions Terrain Vague, Innen, et d’autres encore me font régulièrement confiance pour présenter ce que je veux. J’ai eu aussi la chance de pouvoir travailler avec des artisans spécialistes de l’estampe, de la gravure à la lithographie en passant par la linogravure. De ces collaborations naissent de nouvelles idées qui m’emmènent ailleurs.

En Juillet 2021, on a pu te retrouver aux côtés de Virgil Abloh pour Off-White, d’abord sur le pop-up au shop (avec la fameuse camionnette peinte) et après sur le défilé (avec M.I.A. qui performe à la fin) – et toutes les images qui viennent alors sur les réseaux sociaux de Virgil ou Off-White. Beaucoup de gens ont pu découvrir alors ton nom (et ton compte Instagram), et ton travail : une mise en lumière très importante sur un laps de temps très court. Peux-tu nous raconter la rencontre avec Virgil sur ce projet et le contexte de cette collaboration ?
Tout commence le jour où Hugo Vitrani (curator au Palais de Tokyo, ndlr) me contacte pour peindre des camions. Je n’en sais pas beaucoup plus, à part que c’est pour un défilé de mode. Hugo supportant et connaissant mon travail depuis un certain temps, il ne m’a pas fallu longtemps pour lui dire oui. Je lui fais confiance, il connaît mon positionnement, il sait ce que j’aime et ce que je suis capable de faire. Il n’y avait pas de malentendus possibles. J’ai été surpris d’apprendre que c’était pour le défilé Off-White et que Virgil Abloh voulait que je déglingue deux camionnettes avec des throw-ups. Je reçois rapidement des images sélectionnées par Virgil sur mon compte Instagram. Un brin dubitatif, je me rends sur le lieu de préparation du défilé avec tout mon attirail, en gardant en tête la participation de Lewy BTM en compagnie de Futura à un défilé Vuitton en 2019. Pour info, les BTM ne font pas dans le détail, ils sont représentatifs de la branche new-yorkaise du graffiti hardcore que j’apprécie particulièrement. J’attaque donc les camionnettes avec mon throw-up en différentes tailles, au squeezer bien coulant. J’hésite à en ajouter encore quand on me transmet l’appel d’un des assistants de Virgil qui en demande encore plus. Ambiance surréaliste, je me retrouve à éclater la deuxième camionnette place Vendôme, filmé et photographié par l’équipe d’Off-White Imaginary TV. Le lendemain, les camionnettes circulent dans Paris diffusant les lives de l’émission radio temporaire. Hugo me propose alors d’y passer pour faire de nouveaux throw-ups, Virgil semble avoir apprécié la prestation de la veille. Alors qu’il s’entretient avec M.I.A. je me retrouve à peindre en live. Virgil prend le temps de venir nous saluer et de poser un throw-up avant de nous proposer de nous servir dans la boutique. Dans la foulée, il me propose de peindre sur le lieu du défilé qui a lieu deux jours plus tard. Une nuit de travail dans une ambiance spéciale avec Hugo Vitrani, Idéefixe, Pablo Tomek et Thibault Classic, suivie du défilé auquel on est tous invité. Tout s’est enchaîné très vite de manière fluide avec une mise en lumière aussi furtive qu’efficace.
Les retombées de cette collaboration avec Off-White t’ont-elles amené à travailler de nouveau avec des marques de cette envergure ? Est-ce quelque chose que tu recherches ?
J’ai conscience que cet épisode est exceptionnel et rare. Je pensais que c’était un one-shot, mais encouragé par Hugo Vitrani, j’ai maintenu le contact avec Virgil. Assez dubitatif connaissant son emploi du temps, j’ai été très surpris de voir qu’il prenait le temps de répondre aux messages que je lui envoyais, toujours partant pour différentes suggestions ou idées, tout semblait possible. J’ai appris par la suite qu’il maintenait un lien direct, sans intermédiaire, avec de nombreuses personnes. C’était sa manière de travailler, d’avoir toujours des coups d’avance et de garder un œil sur ce qui l’intéressait. Les choses ont changé après sa disparition. Après la stupeur suite à l’annonce de son décès et les différentes commémorations, le rythme frénétique de la mode a repris son cours. Virgil Abloh apportait une respiration et une curiosité bénéfiques dans cet univers très cloisonné. J’ai eu quelques touches suite à cet épisode, mais rien de définitif avec des marques de cette envergure. Grog, une marque italienne d’encre et de markers me soutient depuis, heureuse de voir que j’avais utilisé ses produits pour Off-White. Le temps semble s’être un peu ralenti, mais je reste évidemment ouvert à toutes sortes de propositions. J’ai compris la nécessité pour moi de passer de l’ombre à la lumière et de sortir d’une certaine forme de clandestinité. La mode, quand elle est entre les mains d’une personne comme Virgil Abloh, peut mettre en lumière un aspect radical du graffiti en faisant rayonner la beauté de sa brutalité. Par ce processus d’accaparement, la mode extrait l’essence du graffiti pour le sanctifier. Rien n’égale les moyens et l’influence de la mode qui dicte les formes à venir. Au-delà d’une futilité assumée, la mode en quête de nouveauté et de renouveau permanent permet d’élargir les horizons, y compris, je pense, celui d’une certaine forme de graffiti.
Tu fais aussi de l’aquarelle – comment y es-tu venu et en quoi est-ce une suite logique et complémentaire à ton œuvre graffiti art selon toi ?
Je me suis mis à l’aquarelle grâce à Omick et Spé qui m’ont montré les qualités et les avantages de cette technique. Demandant assez peu de moyens et d’espace, elle s’inscrit dans mon envie de peindre simplement, à plat sur la table de mon salon. J’aime ce rapport au papier moins noble et moins précieux que la toile. Si c’est raté, je déchire et je recommence. L’aquarelle se situe entre le dessin de croquis et la peinture, c’est un entre-deux. Souvent réservé à un travail préparatoire ou à l’esquisse, c’est une étape pour certains peintres d’atelier. Comme dans le graffiti que je pratique, le premier geste est souvent le dernier, il n’y a pas de retouches possibles. Je me sens plus libre dans la composition devant une feuille de papier aquarelle que devant une toile. Moins intimidé par la technique, je peux me laisser guider par l’aléatoire des couleurs flamboyantes qui fusent. J’y explore à ma manière les genres de la peinture de Vanités et de la nature morte auxquelles je superpose des squelettes de lettrages issus de mes carnets de sketches, pour composer des paysages mentaux. Ma fascination pour les natures mortes vient de mon observation des plantes sauvages quand je peins à l’extérieur et des fleurs en vase dont les formes et les couleurs m’inspirent. C’est une pratique modeste qui s’inscrit dans mon rapport à l’art folklorique, à l’artisanat ou à l’illustration en BD. C’est un prolongement naturel de ce que j’expérimente quand je sors peindre.
Pour revenir au graffiti, il y a plusieurs variétés d’outils que l’on retrouve dans ton travail, des bombes aérosol à la Baranne (cirage pour chaussures) ou les marqueurs plutôt liquides… As-tu un outil de prédilection ?
Mes outils de prédilection sont dans le désordre : le cap d’origine pour son côté brutal et rugueux qu’il donne à mes contours, les squeezers, libre adaptation des barannes par Grog, une marque italienne dont j’apprécie les différentes encres et la craie grasse de marquage industrielle que je peux glisser dans ma poche sans risque de me tacher…
Dans l’actualité et tes projets, as-tu des choses à nous dire ?
J’ai plusieurs livres et fanzines qui doivent sortir chez différents éditeurs indépendants (Hobo Books, Two & The Same Press…) dont une collaboration avec Paul Loubet et l’atelier Stamp. Je travaille évidemment sur le suivant. J’ai d’autres choses en tête, j’aimerais notamment refaire des objets en céramique, écrire de nouveaux textes plus longs, me mettre plus sérieusement à la vidéo et à la captation de sons (field recording) et continuer à peindre en extérieur… Ce n’est pas d’idées dont je manque, mais de temps pour toutes les réaliser.
Sans vouloir passer pour un donneur de leçons ou un vieux sage que je ne suis pas, le graffiti et le skate sont des pratiques exigeantes. Elles méritent toutes deux qu’on s’y investisse, qu’on se documente et qu’on les questionne pour les saisir. Le champ des possibles est infini, voir vertigineux. Depuis que toutes les informations circulent librement sur internet, le plus compliqué est de les hiérarchiser, de faire le tri, pour se constituer une base de réflexion stable permettant de développer sa pratique. Et si vous avez des projets en tête, n’attendez pas qu’on vienne vous chercher pour les réaliser : l’important c’est de faire !
Un message aux lecteurs/trices ou un dernier mot ?
Sans vouloir passer pour un donneur de leçons ou un vieux sage que je ne suis pas, le graffiti et le skate sont des pratiques exigeantes. Elles méritent toutes deux qu’on s’y investisse, qu’on se documente et qu’on les questionne pour les saisir. Le champ des possibles est infini, voir vertigineux. Depuis que toutes les informations circulent librement sur internet, le plus compliqué est de les hiérarchiser, de faire le tri, pour se constituer une base de réflexion stable permettant de développer sa pratique. Et si vous avez des projets en tête, n’attendez pas qu’on vienne vous chercher pour les réaliser : l’important c’est de faire !
QUI POURRAIT TE PLAIRE



